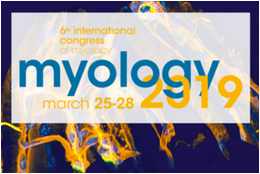 Une étape après l’autre, les méthodes de thérapie génique s’affinent et se diversifient avec déjà des résultats très encourageants, mais aussi des essais cliniques à venir. La preuve par une session dédiée en ce troisième jour de congrès.
Une étape après l’autre, les méthodes de thérapie génique s’affinent et se diversifient avec déjà des résultats très encourageants, mais aussi des essais cliniques à venir. La preuve par une session dédiée en ce troisième jour de congrès.
Différents traitements basés sur l’utilisation de matériel génétique sont en développement dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). La plupart reposent sur la délivrance, par un virus adéno-associé (AAV), d’un gène codant une micro-dystrophine.
Deux nouvelles voies prometteuses
A Myology 2019, Kevin Flanigan du Center for Gene Therapy (Columbus, États-Unis) a présenté deux alternatives qui utilisent également des AAV. La première vise à corriger les conséquences de la maladie par la délivrance du gène GALGT2. Sa surexpression entraine la production dans la fibre musculaire d’utrophine, une protéine proche de la protéine manquante dans la DMD (dystrophine). Cette approche fait l’objet aux États-Unis d’un essai clinique de phase 1/2 mené chez des garçons âgés de plus de 4 ans pour évaluer le trio AAV – MCK promoter – GALGT2 injecté dans des vaisseaux (artère et veine) de chaque cuisse. Présentés par Kevin Flanigan lors de Myology 2019, les résultats préliminaires pour deux participants montrent que le traitement est bien toléré et qu’il existe, à ce jour, une preuve d’efficacité limitée (pas de déclin évident fonctionnel ni moteur). La seconde approche consiste à fournir plusieurs copies d’un petit ARN nucléaire (ARNs-U7) transporté par un AAV, avec l’objectif de réaliser l’exclusion de l’exon 2 (saut d’exon) du gène de la dystrophine. Testée chez la souris, cette stratégie entraine bien une expression prolongée de dystrophine. Un essai clinique serait prévu pour 2019.
Après la SMA, la SLA
La thérapie génique est également d’actualité pour les formes génétiques, familiales, de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette maladie se traduit par une dégénérescence des motoneurones, comme l’amyotrophie spinale proximale liée à SMN1 (SMA). Dans la SMA comme dans la SLA, il faut utiliser un vecteur viral capable d’atteindre le système nerveux central, où se trouvent les motoneurones. Après avoir développé un AAV de type 9 pour la SMA, l’équipe de Martine Barkats (Institut de Myologie, Groupe Biothérapies des maladies du motoneurone (SLA & SMA)) a mis au point une thérapie génique utilisant un AAV10 pour transporter un petit ARN nucléaire (ARNs-U7) capable, par un mécanisme de saut d’exon, de réduire les niveaux toxiques d’une protéine mutée (SOD1) impliquée dans 20% des formes familiales de SLA. Maria-Grazia Biferi (Institut de Myologie, Groupe Biothérapies des maladies du motoneurone (SLA & SMA)) a rappelé que cette stratégie s’avère efficace chez des souris modèles de la maladie, avec une prolongation de la survie de plus de 70%. L’équipe s’attache désormais à optimiser cette thérapie dans la perspective d’une application à l’Homme. En parallèle, elle développe une approche comparable dans une autre forme familiale de SLA, liée cette fois au gène C9ORF72.
Un rêve devenu réalité dans la myopathie myotubulaire
Les développements de thérapie génique sont plus avancés pour une maladie neuromusculaire congénitale lié à l’X et due à des mutations du gène MTM1, la myopathie myotubulaire. Elle entraine le plus souvent un décès dans la petite enfance, avant l’âge de deux ans dans plus de 50% des cas. L’équipe d’Ana Buj-Bello (Généthon, Evry) a développé une biothérapie basée sur l’administration intraveineuse d’un AVV recombinant de type 8 pour délivrer le gène MTM1 à l’ensemble des muscles. Ses résultats spectaculaires chez des animaux modèles de la maladie ont permis le lancement, en septembre 2017, d’un essai clinique international (étude ASPIRO) mené par Audentes Therapeutics en partenariat avec Généthon. Il a inclus huit garçons âgés de moins de cinq ans atteints de myopathie myotubulaire. Des résultats préliminaires ont été dévoilés par Ana Buj-Bello : à un an de leur inclusion, tous les participants se sont améliorés sur le plan moteur et respiratoire. Ils ont atteint et maintenu leurs acquisitions motrices (tenir sa tête, se tenir assis sans appui…). Trois enfants n’ont déjà plus besoin d’assistance respiratoire.
